Si la gauche radicale connaît actuellement des difficultés en France, d'autres expériences - notamment Syriza en Grèce ou Podemos dans l'Etat espagnol - permettent d'espérer et invitent à penser. Nous reproduisons ici un article initialement publié le 23 juin 2014 sur Viento Sur, puis traduit et publié en français par la revue en ligne Alencontre. L’auteur Brais Fernandez, est militant d’Izquierda Anticapitalista et participe à Podemos. Dans cet article, il revient sur les origines et la signification politique du mouvement Podemos qui a émergé dans l'Etat espagnol, dans le sillage du mouvement des Indignés et des "marées".
Sources : Contretemps mis par Brais Fernandez publié le 23 juin 2014
L’apparition de Podemos a déboussolé le paysage politique. Dans une situation de blocage institutionnel, où l’instabilité paraissait plutôt être le fruit de la crise des vieux partis que celui de l’apparition de nouveaux acteurs, Podemos émerge comme une grande menace pour ceux d’en haut et un grand espoir pour ceux d’en bas.
Après des années de mobilisations et de dynamiques de lutte essentiellement défensives, la marée d’indignation qui s’est manifestée avec le mouvement revendicatif du 15M [15 mai 2011: mouvement des «Indigné·e·s»] cherche à se doter d’outils en vue de lutter pour la conquête de fractions de pouvoir institutionnel, en provoquant un changement de cycle: les classes subalternes ne se contentent plus de protester, elles cherchent désormais à transformer leur propre narration, leur propre récit, en pouvoir politique. Un secteur de la population commence à croire, de nouveau, à la possibilité de construire une société égalitaire et démocratique: l’irruption populaire discrédite la politique traditionnelle.
Dans cet article nous tenterons de répondre brièvement à quelques questions. Pourquoi Podemos a-t-il été lancé et par qui? Quel est le rapport entre Podemos et les identités de la gauche? Ainsi que quelques points concernant les éléments du discours politique, les formes et modalités d’organisation et les défis à venir. Il resterait encore bien des aspects intéressants à aborder, mais je vous invite à lire cet article simplement comme une réflexion inachevée ou une contribution au débat.
 De l’interprétation d’un moment à la création d’un événement
De l’interprétation d’un moment à la création d’un événement
Rompant avec l’idée selon laquelle il «faut accumuler des forces lentement», le lancement de Podemos répond à une vision combinant une analyse «objective» de la conjoncture politique avec une utilisation «subjective» de cette dernière. D’un côté, la conjoncture fraie un chemin vers une possibilité politique: les luttes de défense du secteur public (santé, éducation, etc.), le discrédit des organisations sociales et politiques traditionnelles, la bureaucratisation de la gauche institutionnelle, la désaffection et la colère d’amples couches de la population, la recherche d’une issue politique aux mobilisations constituent quelques-uns des symptômes indiquant qu’un projet comme celui de Podemos avait des chances de réussir. D’un autre côté, la réunion de ces caractéristiques ne conduit pas, en elle-même, à entraîner un quelconque changement fondamental de l’ordre politique. Pour impulser la construction d’acteurs (de sujets) qui vont créer des événements en fonction des possibilités existantes, il importe de tirer parti de la conjoncture pour bénéficier d’un élan. Ce qu’il faut pour que la réalité cesse d’être un puzzle dont toutes les pièces doivent pouvoir s’emboîter implique de commencer à construire le puzzle avec les pièces qui sont à disposition, même si elles ne s’emboîtent pas toutes.
 Un lancement avec les forces accumulées
Un lancement avec les forces accumulées
Podemos fut lancé par les personnes regroupées autour de l’émission (de TV) de débat politique La Tuerka – dont Pablo Iglesias est la figure de proue – et par des militant·e·s d’Izquierda Anticapitalista. Deux cultures politiques différentes se sont rencontrées. La première, celle qui a trouvé son inspiration dans les processus en cours en Amérique latine, avec une hypothèse fondée sur la possibilité d’une agrégation populaire autour d’une figure charismatique permettant de faire confluer diverses expressions de mécontentement. La seconde, issue une culture «mouvementiste», fondée sur la volonté de construire une alternative de rupture à partir d’en bas et à gauche, très marquée par les expériences du 15M et des mareas [les «marées» ou mouvements sociaux, il en existe plusieurs, caractérisées par leurs couleurs, blanche dans la santé, vert dans l’éducation, grenat pour les «exilés du travail», etc.].
L’utilisation d’une figure publique «forte», plus connue par ses apparitions télévisées que pour être le dirigeant d’un mouvement – comme peut l’être Ada Colau[1 – a été et continue d’être controversé. Mais, au-delà des débats, il faut reconnaître que, sans la figure de Pablo Iglesias, Podemos n’aurait pas dépassé le stade d’autres expériences sans pouvoir d’agrégation populaire, allant au-delà des espaces militants déjà constitués. Et je me réfère à Pablo Iglesias comme figure construite pour souligner une réussite indéniable: derrière cette figure, il y a une interprétation de la nécessité de se construire également sur le plan médiatique, eu égard au rôle que jouent les «mass media» dans les sociétés actuelles. Pablo Iglesias est le produit d’une stratégie, et bien que les opportunités soient toujours contingentes, il faut savoir en profiter. Le mérite revient à celui qui a saisi qu’il y avait un espace à occuper ainsi qu’une accumulation de forces potentielles permettant de le faire. Et il a fait en sorte de transformer ce potentiel en quelque chose de concret. La légitimité de Pablo Iglesias dans la direction de Podemos provient du fait qu’il a su construire, par le biais des haut-parleurs médiatiques, une voie de communication directe avec des millions de personnes qui s’identifient avec les questions qu’il soulève. Le débat ne s’articule pas autour de la nécessité ou non d’une direction de ce type – qui a démontré être très utile pour impulser un vaste projet fondé sur l’auto-organisation populaire – mais plutôt sur le thème portant sur la manière de combiner se modèle de direction médiatique avec la culture égalitaire et «venant d’en bas» qui est apparue avec le 15M. La tentative, non dépourvue de tensions, d’aller dans le sens de réunir deux sphères explique en bonne partie le succès de Podemos. Dans ce domaine, il reste encore beaucoup d’expériences à faire.
Par ailleurs, un secteur de la gauche radicale (radicale dans le sens d’une recherche de réponses allant à la racine des problèmes endémiques) a été capable de mettre ses (modestes) forces militantes au service de l’ouverture d’un espace qui ne peut être contrôlé par quelque organisation que ce soit. Forces qui cherchent à faire confluer de nouveaux secteurs sociaux au-delà de positions politiques prédéfinies. Il s’agit, en effet, de mettre l’organisation au service du mouvement, abandonnant l’idée que l’on «intervient de l’extérieur» ou de penser qu’il existe des camps politiques fixes. La tâche consiste à participer à des expériences massives, tout en en assumant les contradictions et les formes qui sont plus imposées par les rythmes réels de la situation qu’issues d’un travail patient et organisé. A de nombreuses reprises cette situation produit certaines tensions entre des militant·e·s très idéologisés et le développement politique d’un mouvement composé majoritairement de gens sans expérience militante, dont les liens ne s’établissent pas souvent sur la base de l’activité militante traditionnelle. Il existe un risque réel de désaccouplement entre les noyaux militants (qui ne proviennent pas nécessairement d’une organisation concrète, car il y a des militant·e·s très différents) et cette base sociale vaste et diffuse de Podemos. Ce risque est réel et toujours présent dans un mouvement qui, en raison de ses caractéristiques propres, comprend des formes multiples et variées de liens entre ses membres, au même titre que de degrés de participation.
Il est possible qu’un certain changement de mentalité soit nécessaire pour que les militant·e·s, outre le fait d’être des «protagonistes» politiques, assument également une certaine volonté de se mettre en relation avec tous les gens qui s’identifient avec Podemos mais qui ne sont pas disposés à s’impliquer dans des dynamiques activistes.
 Mettre le « faire » avant l’ « être », afin de pouvoir « être » à nouveau
Mettre le « faire » avant l’ « être », afin de pouvoir « être » à nouveau
La défaite de la gauche traditionnelle (chute du mur de Berlin, adaptation de la social-démocratie au néolibéralisme, impuissance de la gauche radicale) est à l’origine de ce que, au contraire d’époques antérieures en Europe, la symbologie « rouge » n’est plus l’élément d’identification par lequel s’exprime le mécontentement anticapitaliste. Ce qui devient central comme élément d’ancrage est ce qu’il «faut faire» qui l’emporte sur «ce que l’on est». Pour le dire en employant des mots de Miguel Romero: «Il est possible et important de créer une organisation politique dont la force et l’unité s’établissent au-delà de l’idéologie, nous concentrant sur la définition des tâches politiques centrales.»
Cela ne signifie nullement que cette priorité de «l’agir» empêche la reconstruction d’identités, car il y a toujours en politique une relation de tension avec le passé, une force qui nous impulse provenant de très loin, ainsi que l’expliquait Walter Benjamin [dans ses « Thèses sur l’histoire » de 1940]. Il suffit de voir l’étonnante récupération-transformation de meetings [dans de vastes espaces, souvent dehors, en public] en tant que «théâtre politique» qu’a réalisée Podemos: les poings levés; Carlos Villarejo2 citant Engels ; Teresa Rodríguez [députée européenne de Podemos, membre de Izquierda Anticapitalista], saluant les luttes locales de travailleurs, les chants de combats ; ou, encore, Pablo Iglesias évoquant ce qu’il y a de meilleur dans le mouvement ouvrier.
Cette conception du meeting comme espace vivant, performatif [décrivant l’action et impliquant cette action], conditionne l’évolution de Podemos sur le plan de l’esthétique et du discours: sur ce théâtre d’un «type nouveau» –que sont devenus les meetings de Pablo Iglesias et d’autres figures publiques du mouvement – le public non seulement observe, admiratif, mais il agit, il fait pression, il vit. Cette ouverture d’espaces pour l’expression populaire – ce qui est le grand mérite de Podemos – a permis au peuple de gauche de se réunir avec lui-même, mais a également obligé la gauche à sortir de sa léthargie identitaire. Podemos a fonctionné dans cet équilibre, tendu et précaire, permettant au projet de partir de la gauche, d’ouvrir un nouveau champ au-delà de cette identité, pour ensuite la recomposer, mais sans jamais s’y enfermer. Etre de gauche revient à la mode parce que ce n’est déjà plus quelque chose qui se vit dans la solitude et avec un symbole accroché à la boutonnière.
 Le jeu des concepts
Le jeu des concepts
Podemos a atteint un équilibre difficile pour la gauche: apparaître comme «le nouveau» tout en puisant cette force qui provient de l’observation du passé pour y chercher de l’inspiration. Deux exemples nous permettront d’illustrer cet aspect: tout d’abord, l’introduction «depuis l’extérieur» du terme «caste»; ensuite la contestation de l’identité «socialiste» du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol), l’un des piliers du régime constitutionnel de 1978.
L’introduction du terme « caste » met clairement en évidence la puissance discursive de Podemos. Il s’agit d’un concept suffisamment ambivalent et sibyllin pour pouvoir établir un axe antagoniste, cela dans un contexte où les responsables de la débâcle sociale se montrent invisibles ou strictement individualisés. Traditionnellement, dans la théorie politique issue du marxisme, le terme «caste» a été utilisé pour se référer aux couches de la population dont le pouvoir émanait de leurs relations avec l’Etat, alors que le terme «classe» était relié à la position face aux moyens et aux rapports de production et de propriété. Le terme «caste» peut être l’expression de cette fusion entre le pouvoir économique et les appareils de l’Etat typique de la période néolibérale ; fusion produite par l’invasion financière de champs de gestion étatique qui, au cours de la période du «Welfare», reproduisait les conquêtes sociales de la classe laborieuse. Le terme «caste» se transforme en une représentation, simple et directe, des responsables économiques et politiques de la misère, de la fusion entre les pouvoirs publics et privés. Ce terme pourrait se convertir en synonyme de ce que le mouvement ouvrier a nommé la «bourgeoisie».
Cette capacité du terme «caste» de symboliser la fusion entre les pouvoirs économiques et politiques possède également sa base matérielle dans le mouvement réel: que l’on se reporte au slogan qui lança le 15M, rappelant que «nous ne sommes pas des marchandises aux mains des politiciens et des banquiers».
Un terme aussi ambigu que celui de «caste», sans ces expériences collectives antérieures, aurait pu se transformer également en une représentation faussée de tous les maux, un recours populiste occultant les responsables authentiques de la crise, ainsi que cela s’est produit en Italie où le principal porte-drapeau de la lutte contre la «caste» est le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui a fini par négocier la formation d’un groupe parlementaire avec l’UKIP (le parti d’extrême droite vainqueur des dernières élections européennes en Grande-Bretagne) au Parlement européen. Cet accord a été approuvé, selon une forme classique du Mouvement 5 étoiles, grâce à une consultation en ligne.
Ceci ne discrédite pas le référendum en ligne (sans doute l’un des outils les plus utiles[3 pour amplifier la participation populaire), ni l’usage du terme «caste», mais cela nous rappelle que ce sont les processus sociaux collectifs qui détiennent le poids décisif. Ce sont eux qui définissent la signification d’un terme et déterminent l’utilisation dans un sens ou dans un autre des mécanismes de participation online.
Il ne faut pas non plus oublier que le duel entre les termes «la caste» et «les gens» se produit dans le cadre de relations structurelles de domination et d’exploitation capitalistes: la «caste» est exploiteuse, mais elle se maintient et se reproduit dans un cadre systémique. C’est l’action politique des gens qui peut déloger la «caste», non seulement pour la remplacer par une nouvelle couche de gouvernants «plus justes», mais pour désarticuler ces rapports (relations entre l’être humain et l’environnement fondées sur la rapine, l’expropriation par quelques-uns de la richesse produite par le travail, des relations d’oppression hétéropatriarcales) qui déterminent la vie sociale.
La force de Podemos réside en ce que le concept n’est pas détaché de l’action réelle, et ainsi s’ouvre la possibilité de lier la lutte contre la «caste» à la possibilité de dépasser les structures et les rapports qui permettent et conditionnent la reproduction de la «caste». Au sein de ce processus de lutte apparaissent des éléments d’auto-organisation populaire, de nouvelles relations sociales qui remettent en question celles imposées par la société capitaliste: la lutte contre «la caste» se forge dans la coopération et le débat, cela à l’opposé de la mise en concurrence, de l’isolement social et de la solitude que produit le néolibéralisme.
Par ailleurs, Podemos a eu l’audace (liée à la possibilité ouverte par la fragilité des loyautés politiques établies par le régime de 1978) d’aller contester les bases sociales du PSOE. Le PSOE a fonctionné au cours des dernières décennies comme le principal élément «partidaire» d’intégration des classes subalternes à l’Etat espagnol, un rôle fortement lié à sa subordination et fusion avec les appareils de l’Etat. Les mécanismes pour cette intégration ont été multiples. Les plus notables sont ses liens avec les syndicats, une politique de réformes destinée à stimuler un modèle économique qui échangeait les aides européennes (UE) contre une désindustrialisation du pays. L’endettement servait d’instrument de compensation de la stagnation salariale. Dans la foulée s’opérait une financiarisation du système productif. L’effondrement de ce modèle, à partir de la crise de 2008, a également signifié une forte érosion de son rôle de référence sociale pour tout ce secteur de la classe laborieuse qui considérait jadis le PSOE comme un moindre mal comparé à la droite. Podemos a su se réapproprier le terme «socialiste» pour se positionner en tant qu’alternative face à la ruine de la «marque d’origine», y compris au moyen d’un «jeu discursif» s’appuyant sur une donnée aléatoire: le dirigeant de Podemos et le fondateur du PSOE portent le même nom [Pablo Iglesias, 1850-1925, il fut aussi dirigeant de l’UGT]. Ainsi, Podemos accuse le PSOE d’abandonner ses objectifs fondateurs et appelle à les récupérer dans le cadre de la construction d’un nouveau sujet politique. Les socialistes peuvent ainsi retrouver la fierté de l’être, mais en dehors du PSOE, perçu comme un cadre caduc et en voie de décomposition.
Si nous comprenons le «sens commun» à la manière de Gramsci, c’est-à-dire comme une synthèse entre l’idéologie de la classe dominante et les conquêtes contre-hégémoniques des subalternes dans leur lutte contre cette idéologie dominante, il ne fait aucun doute que l’ambivalence discursive de Podemos permet de recueillir une bonne partie du capital historique accumulé autant par les luttes que par l’histoire du mouvement des opprimé·e·s. Mais cette ambivalence – indispensable et si utile pour un processus d’agrégation populaire massif – devra également faire face à des défis dictés par l’agenda politique dominant. Un agenda, ne l’oublions pas, qui continue d’être marqué par des faits étrangers aux actions de Podemos, même si ce dernier constitue déjà un élément de l’équation. Que se passera-t-il le jour de la consultation catalane [prévu le 9 novembre 2014] ? Le sens commun qui domine dans une grande partie – voire la majorité – de ceux qui s’identifient à Podemos ne les pousse pas précisément dans le sens d’un soutien au droit des Catalans à décider [l’indépendance], même si certains dirigeants de Podemos ont défendu le droit de décider des Catalans. Beaucoup de pédagogie et de courage seront nécessaires pour que ne s’impose pas en Espagne le sens commun dominant, c’est-à-dire celui de l’unité de l’Espagne. Mais Podemos, au moins, a ouvert la possibilité de résoudre cette situation de manière démocratique.
 On n’invente pas les formes
On n’invente pas les formes
L’une des caractéristiques des périodes de reflux réside dans le fait que la gauche a tenté d’intégrer les personnes dans ses propres structures plutôt que d’aller vers les structures que «génèrent» les gens. C’est, jusqu’à un certain point, compréhensible. S’il n’y a pas de mouvement, il n’y a pas de lieu où aller, ce qui entraîne le repli et l’isolement. C’est la raison pour laquelle les attaques gratuites, très à la mode dans certains secteurs, contre la gauche qui a résisté à toute la vague néolibérale qui a précédé le 15M sont souvent peu matérialistes et injustes. La tragédie n’est pas cette résistance, qui ne mérite que le respect. La tragédie se produit plutôt lorsqu’il y a un changement d’époque, lorsque le mouvement surgit dans l’histoire. Les tentatives de ne pas disparaître en périodes de reflux ou de crise du mouvement se concrétisent souvent sous forme de tendances bureaucratiques, car sans la pression de ceux d’en bas, ce sont les institutions dominantes qui font pression à partir d’en haut. C’est ainsi que les organisations traditionnelles de la gauche ont eu une tendance à se transformer en appareils conservateurs en raison de la pression générée par les liens avec les appareils de l’Etat et les dynamiques de résistance basées uniquement sur la lutte électorale.
Lorsque le mouvement populaire fait de nouveau irruption, toutes ces routines sont remises en question. La marée du 15M fut précisément cette irruption du mouvement, après le désert et l’apathie néolibérale, avec le retour du collectif, avec la création de formes organisationnelles qui répondaient aux problèmes de la majorité de la population, à la réalité quotidienne des gens. Emmanuel Rodriguez dans son ouvrage Hipótesis Democracia décrit à la perfection les formes que propose (et impose) le mouvement 15M : « Ample, sous forme d’assemblées, sans structures déterminées, dans la rue et sur la toile. Spontanément, sa forme s’adapte à celle d’un mouvement constituant dans lequel peut participer n’importe qui. Les assemblées sont ouvertes et peut y participer qui le souhaite ».
Podemos tient sa force précisément dans le fait de ne pas tenter d’imposer des formes, mais en permettant de reprendre celles qui ont été expérimentées sur les places, ouvrant des espaces de participation pour les gens. Cela explique la capacité que possède Podemos «d’additionner»: on n’exige pas aux gens de s’intégrer dans une structure prédéfinie, mais est offert plutôt un espace à configurer. Cela différencie Podemos du reste des organisations politiques. Avec Podemos, on parlerait plutôt d’auto-organisation, d’un «do you it yourself» opposé au modèle des organisations politiques de la gauche traditionnelle où la relation entre militant et structure est préfigurée à l’avance.
Ce grand avantage n’est pas exempt de problèmes. Les problèmes les plus immédiats sont provoqués par la nécessité de donner forme à des structures propres, capables d’agir de manière pratique, de s’adapter aux temps imposés par la vie quotidienne. Le défi consiste à parvenir à adapter la participation à la vie et non la vie à la participation. Pour cela, la définition de structures peut être utile pour qu’après le moment d’euphorie initial ne se perde pas l’impulsion démocratique. Il faudra examiner si cette génération de structures est capable de se diffuser depuis en bas jusqu’en haut. En raison des caractéristiques mêmes du projet (lancé «depuis en haut»), l’espace depuis lequel se dirige le projet est «fermé». D’où le fait que nous nous trouvons, de facto, en présence de deux processus parallèles dans Podemos qui n’interagissent pas. L’un, à partir d’en bas, expérimental, créatif, ouvert et un autre, d’en haut, fermé, beaucoup plus rapide au moment d’agir, qui envoie des décisions à l’ensemble de Podemos. Il est nécessaire d’équilibrer progressivement cette relation entre «en haut» et «en bas», sans perdre de vue que ce qui se bouge dans les marges, en produisant des mécanismes de contrôle et de décision qui parcourent tout l’espace de Podemos. La nouvelle période qui s’ouvre, dans laquelle Podemos sera lié aux institutions (et à ses «récompenses» matérielles), est également un cadre connu pour un processus accéléré de bureaucratisation s’il n’y a pas un fort contrôle de la base, si ne s’élaborent pas des canaux qui coulent de haut en bas et de bas en haut. Il ne s’agit pas de liquider la capacité de décision des cercles exécutifs, mais plutôt de créer la possibilité de les élire et de les contrôler par des assemblées, introduisant des principes de rotation et de révocabilité, en cherchant un équilibre entre l’autonomie des cercles4 et l’ensemble du projet. Le discours de Podemos a beaucoup insisté sur la participation et le contrôle démocratique, avec pour objectif de modifier la logique de la représentation. Reste à créer les conditions qui ont été énumérées pour sa concrétisation.
Il ne faut pas masquer les tensions qui peuvent naître dans un espace aussi hétérogène que celui de Podemos. Ces dernières ne peuvent être «gérées» que si l’on produit un cadre stable, toujours ouvert et suffisamment fort pour pouvoir engendrer une nouvelle culture politique qui fasse que tous les débats soient canalisés par des structures démocratiques, surgies depuis la base, perméables à la société. Ces mécanismes ne doivent pas être paralysants puisqu’ils ont comme objectif la bataille politique contre les classes dominantes. Mais ils doivent en même temps intégrer ce qui différencie Podemos de la simple efficacité technocratique.
L’une des grandes différences de Podemos par rapport à d’autres formations réside dans le fait que les mécanismes qui lient les gens permettent de décider, de donner son opinion tout en visant à donner des solutions aux débats politiques. C’est la raison pour laquelle – au-delà de l’élan généré par l’espérance première – se fait nécessaire une nouvelle culture qui rompe avec la vieille politique basée sur les familles politiques, les réseaux informels ou les réunions de couloir. Ces structures ne peuvent se construire que si le pouvoir (qui, en dernière instance, est une fiction, un accord consensuel que toutes les parties acceptent) émane de structures visibles, transparentes, fondées sur des règles claires et simples. Ce type de mécanismes est le plus utile pour produire une identité commune basée sur «l’agir politique», l’appartenance au projet, son caractère non excluant, au-delà les sigles antérieurs, des groupes d’affinité ou simplement de non-inscription identitaire. C’est là le défi interne le plus important auquel fait face Podemos: passer de l’agrégation enthousiaste à la politique au jour le jour, sans perdre en vitalité, en énergie, en émotion, en démocratie. Ce sera difficile mais pas impossible.
 Le défi est de gagner
Le défi est de gagner
L’un des grands paris de Podemos était de rompre avec la dichotomie entre ce qui relève du domaine électoral et ce qui a trait au processus de lutte et d’auto-organisation. Tout au long du processus qui a précédé les élections européennes du 25 mai, Podemos a construit un mouvement politique électoral massif, ayant une vocation de continuité, dans un contexte dans lequel les mobilisations de rue étaient en reflux, à l’exception de la reprise des Marches de la dignité du 22 mars.
D’un côté, ce «processus constituant» n’aurait pas été possible sans l’accumulation de forces provenant des multiples mobilisations antérieures, qui marquent toujours la conscience des phases qui suivent. Mais il est également certain que Podemos a utilisé les élections pour réaménager le champ politique. Pour la première fois, la bataille électorale n’a pas été envisagée comme une «guerre de positions» avec les forces accumulées, mais comme une «guerre de mouvements» rapides, ayant pour objectif de rassembler de nouveaux secteurs sociaux pas liés à l’accumulation des forces produites lors les mobilisations antérieures. C’est cette utilisation des processus électoraux qui a donné naissance à ces cercles qui ont vécu et agi dans la campagne électorale en tant qu’acteurs d’une mobilisation: ils cherchaient à recueillir des voix en même temps que s’ouvraient des espaces pour l’auto-organisation populaire.
Podemos est né avec un horizon concret : déloger les partis du régime des institutions. Mais cela ne signifie pas nécessairement « gagner ». Gagner c’est pouvoir gouverner, plus même, c’est doter les classes populaires de mécanismes pour l’auto-gouvernement en même temps que l’on déloge du pouvoir les classes dominantes, démantelant ses mécanismes de domination. Cela ne se réalise pas par décret, ni du jour au lendemain, il s’agit d’un processus qui, dans le contexte historique actuel, ne peut qu’être initié par une victoire électorale. Podemos doit s’y préparer, affrontant les campagnes électorales sous un angle offensif tandis que, parallèlement, on se prépare à aborder la question du gouvernement au-delà du simple discours. Quelqu’un doute-t-il que le programme de Podemos rencontrerait des résistances venant du capital financier international, des grands entrepreneurs ou de la caste liée aux appareils de l’Etat ? Comment gouverner des municipalités endettées par les politiques néolibérales ? Comment s’opposer à une fuite des capitaux, réaction plus que possible face à l’implantation d’une fiscalité fortement progressive ? Il est nécessaire de construire des pouvoirs populaires préparés à résister à cette pression qui se déchaînera en cas de victoire électorale. Il ne suffira pas de contrer les menaces catastrophistes des grands médias avec des démentis verbaux: la meilleure forme de les combattre sera un peuple qui a confiance en lui-même, préparé à exercer le pouvoir.
Les cercles Podemos sont l’un des espaces indispensables pour affronter cette tâche. Il faut préciser auparavant que les cercles ne sont pas des mécanismes de pouvoir populaire: ils sont des outils, mais ils représentent un plus pour la construction de ce pouvoir populaire au service d’un gouvernement des citoyens et citoyennes. Il s’agit de maintenir des rapports constants et étroits avec les gens des quartiers, des lieux de travail et d’études, en évitant de se limiter à des consultations sur internet, très utiles et indispensables pour faciliter des mécanismes de décision, mais incapables de construire une politique «chaleureuse», appuyée sur la délibération collective et la construction de communautés enracinées dans la vie quotidienne des territoires.
Il s’agit donc de combiner les formules virtuelles et la présence sur le terrain, utilisant tous les instruments à notre disposition pour construire, lier et susciter la participation de la majorité sociale. Cela ne signifie nullement que les cercles doivent prendre toutes les décisions concernant Podemos, mais bien qu’ils doivent participer à l’élaboration des questions présentées à la population, pour éviter que les réponses possibles ne soient définies que par quelques-uns. C’est seulement de cette manière que les cercles se transformeront en espaces ouverts, perméables à la sensibilité et aux problèmes de ceux et celles d’en bas.
Les cercles peuvent également être ce lien entre tout le capital accumulé au sein de la société civile et des institutions. Les tâches sont concrètes: discuter avec les organisations sociales non seulement pour se solidariser avec elles, mais pour recueillir leurs expériences face à l’élaboration d’une alternative de gouvernement – les Marées blanche [santé] ou verte [éducation] ou la PAH [plate-forme contre les expulsions de logement] ont accumulé une expérience précieuse qui devrait servir de base à certaines politiques publiques au service de l’ensemble de la société; tisser des liens entre les forces vives des quartiers et des villes; rendre visibles des problèmes ignorés par les autorités; se transformer en un lieu de rencontre ouvert pour tous les habitants; être un mécanisme pour la formation politique de citoyens qui ont besoin d’apprendre ensemble à se gouverner eux-mêmes…
Tout mouvement transformateur possède plusieurs pieds. L’électoral est l’une d’entre eux. Les activistes en sont un autre. Sans doute, les porte-parole et les figures publiques représentent un autre, indispensable. Nous avons parlé d’élections, d’outils discursifs, de comment utiliser l’énergie militante pour construire un pouvoir populaire.
Mais il reste un quatrième pied pour se mouvoir: les gens «invisibles», ceux qui vivent à la marge de cette expression de la vie publique qu’est la politique. Pour cela, il est nécessaire de comprendre Podemos comme un champ fluide, loin de la rigidité de la politique traditionnelle, qui ne conçoit la construction des sujets que sur la base des expressions visibles. Il nous reste le défi immense d’être l’espérance de ceux qui ne croient en rien, de ceux qui vivent à la marge de l’exercice de la politique, d’être l’espoir de ceux qui vivent désabusés. Cette puissance sociale ne s’exprimera pas jusqu’à ce qu’une force politique comme Podemos ait fait la démonstration qu’elle ne va pas décevoir. Le défi le plus grand de Podemos est de créer de la confiance dans un monde plein de suspicions, où tout a échoué et où il ne reste rien de très crédible[5. Parce que si Podemos ne réussit pas à insuffler cette confiance, il peut surgir des monstres tels que des pulsions totalitaires et des faux idoles. La responsabilité est peut-être excessive pour une force aussi jeune, mais elle est réelle. Il nous revient à toutes et à tous d’être à la hauteur.
Notes

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)






















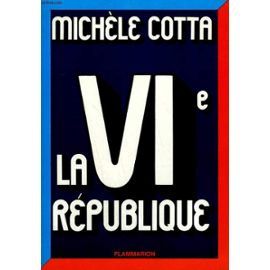



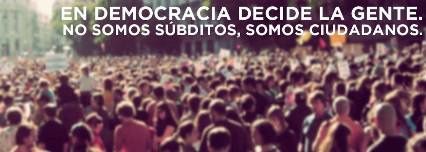



/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)
/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)
/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)
/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)
/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)
/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)