Sources : Athènes le 28/07/2016 par Yanis Varoufakis, (ancien ministre des finances de la Grèce, professeur d'économie à l'université d'Athènes).
Toutes les bonnes choses ont un prix.
Seules les mauvaises, à l’instar des déchets toxiques, présentent un prix négatif, qui équivaut au montant que le protagoniste est prêt à payer pour les faire disparaître. Se pourrait-il que les signifient l’émergence d’une nouvelle vision de l’argent selon laquelle il serait devenu une « mauvaise » chose ?
Au sein des économies de marché, l’argent constitue la mesure de la valeur des biens et des services. Le taux d’intérêt représente le prix de cette mesure – c’est-à-dire le prix de l’argent lui-même. Lorsque ce prix se situe au niveau zéro, peu importe que l’argent soit prêté ou conservé sous un matelas, puisque le coût d’une telle conservation ou d’un tel emprunt est nul.
Question :
- Mais comment est-il possible que le prix de l’argent – qui après tout fait tourner le monde, ou qui « transforme toutes [les] impuissances en leur contraire » – se situe au niveau zéro ?
- Et comment expliquer qu’il puisse devenir négatif, comme c’est actuellement le cas dans la majeure partie de l’économie mondiale, à l’heure où les plus fortunés de ce monde « soudoient » les États pour leur emprunter plus de 5 500 milliards $ ?
La réponse ne peut revêtir qu’une nature que les économistes ont en horreur, à savoir une nature philosophique, politique, et par conséquent irréductible à une explication positiviste et rationnelle. Autrement dit, la réponse doit avoir trait à l’essence même de l’argent.
Sur un marché agricole, les vendeurs qui se retrouvent avec de nombreuses tomates non vendues vont commencer à en baisser le prix, jusqu’à un niveau (éventuellement très bas, mais toujours positif) auquel toutes leurs tomates seront vendues. Par opposition, depuis la crise financière mondiale de 2008, chaque fois que le prix de l’argent a été abaissé, la demande s’y rattachant a chuté, et l’excès d’épargne augmenté. Manifestement, l’argent a quelque chose de différent des tomates et autres « choses » bien définies.
Pour comprendre comment l’argent peut à la fois constituer le bien suprême de nos sociétés et atteindre un prix négatif, il convient tout d’abord de réaliser qu’à la différence des tomates, l’argent ne revêt pas de valeur intrinsèque privée. Son utilité découle de ce que son détenteur peut conduire d’autres individus à faire. Comme le formule Lénine dans sa définition de la politique, l’argent est une question de « qui fait quoi à qui ».
Imaginez que vous soyez entrepreneur et que vous disposiez d’argent déposé dans une banque, ou qu’une banque soit désireuse de vous prêter d’importantes sommes d’argent dans le cadre d’un investissement dans votre activité. Vos nuits sont agitées tant vous hésitez à investir dans un nouveau produit, c’est-à-dire à exploiter votre possibilité d’accéder à de l’argent pour conduire d’autres individus à travailler pour vous. Face à l’actuelle Grande déflation, votre plus grande inquiétude réside dans le futur état d’esprit et pouvoir d’achat de vos clients. Seront-ils capables et désireux d’acheter votre nouveau produit à un prix assez élevé, et en quantités suffisantes ?
Supposons que lors d’une insomnie vous allumiez la radio ou la télévision et découvriez que la présidente de la Réserve fédérale américaine Janet Yellen et le président de la Banque centrale européenne envisagent d’abaisser encore davantage les taux d’intérêt. Vous réjouiriez-vous à l’idée que vos coûts de financement vont diminuer ? Seriez-vous incité à investir désormais votre propre argent, maintenant qu’il s’accompagne d’un taux d’intérêt moins élevé (peut-être même négatif) ?
Certainement pas. Vous réagiriez probablement de manière alarmée à cette nouvelle : « Mon Dieu ! Si Janet et Mario envisagent une nouvelle baisse des taux d’intérêt, c’est qu’ils doivent avoir de bonne raisons de penser que la demande restera faible ! » Vous abandonneriez alors votre projet d’investissement. « Mieux vaut emprunter de l’argent à un prix quasi-nul, » penseriez-vous, « puis racheter davantage d’actions de ma société, booster leur valeur, engranger davantage à la bourse, et encaisser les profits en prévisions de futures périodes difficiles. »
C’est ainsi que le prix de l’argent chute, alors même que l’offre abonde en la matière.
Ces mêmes banquiers centraux qui n’ont pas su prévoir la Grande déflation s’efforcent désormais de trouver une porte de sortie au moyen de modèles économiques et économétriques qui ne sont pas non plus parvenus à l’expliquer, et encore moins à proposer des solutions. Peu disposés à remettre en question le dogme politique selon lequel les banques centrales doivent demeurer apolitiques, ils refusent de considérer l’argent comme davantage qu’une simple « chose ». Ainsi poursuivent-ils leur quête d’une solution de bricolage technocratique à un problème qui réclame pourtant une solution politique philosophiquement astucieuse.
Cette quête est en effet futile. Dès lors que le prix de l’argent (les taux d’intérêt) a atteint le niveau zéro, les banques centrales ont cherché à acheter des montagnes de dettes publiques et privées auprès de banques commerciales, afin de les inciter à prêter gratuitement. La BCE est allée jusqu’à payer les banques pour que celles-ci prêtent aux entreprises, tout en sanctionnant le fait qu’elles refusent de prêter (via des taux d’intérêt négatifs concernant les réserves excédentaires).
Considérant ces mesures comme autant de réponses désespérées à des prévisions de déflation autoréalisatrices, les banquiers et les entreprises sont alors entrés en grève de l’investissement, tout en utilisant l’argent des banques centrales pour gonfler le prix de leurs propres actifs (actions, biens immobiliers, œuvres d’art, etc.). Tout ceci n’a contribué en rien à mettre un terme à la Grande déflation. Les riches sont simplement devenus plus riches encore, résultat qui a en quelque sorte renforcé la croyance des banquiers centraux dans l’indépendance des banques centrales.
Fort heureusement, tous les banquiers centraux ne se montrent pas aussi inefficaces dans la formulation de réponses inventives à la Grande déflation. Andy Haldane, économiste en chef de la Banque d’Angleterre, a que l’argent devienne totalement numérique, ce qui permettrait d’imposer à tous des taux d’intérêt négatifs en temps réel, obligeant ainsi chacun à dépenser en même temps. De son côté, John Williams, président-directeur général de la Banque de réserve fédérale de San Francisco, a que la Grande déflation ne pourrait être stoppée qu’en fixant simultanément le niveau des prix et le revenu nominal national – sorte de New Deal faisant intervenir une action conjointe de la Fed et du gouvernement.
Ce qui distingue ces banquiers centraux du reste du lot, c’est qu’ils sont prêts à en finir avec le mythe d’une politique monétaire indépendante, à reconnaître que l’argent constitue le bien le plus politique qui soit, à défier la sacralité de l’argent en espèces, et à admettre que la lutte contre la Grande déflation exige un programme de mesures politiques progressives.
Simone Weil a dit un jour : « Si vous voulez vraiment connaître un homme, observez la manière dont il se comporte lorsqu’il perd de l’argent. » De même, si nous souhaitons connaître le vrai visage de nos sociétés, efforçons-nous d’observer comment elles réagissent face à des taux d’intérêt négatifs.

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)
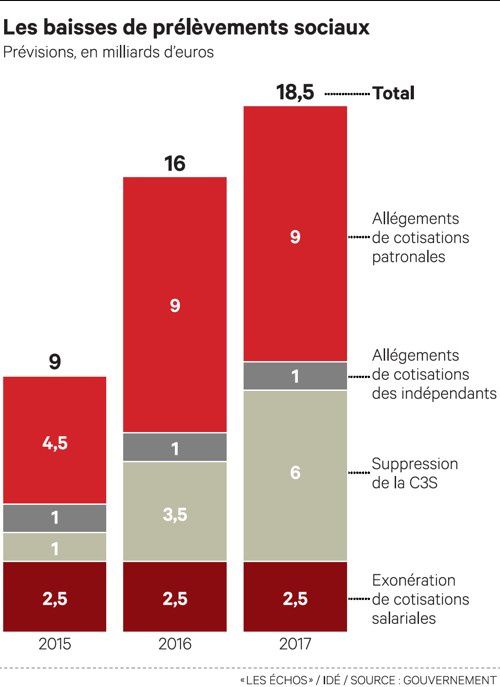












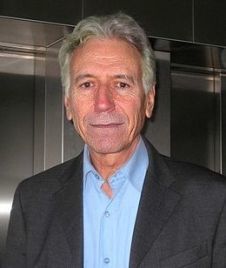











 Ce même Bonaparte prend le pouvoir entre le 18 et le 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799). Son discours au soir de son coup d’Etat est bien connu : « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée ! Elle est finie ! » Ce qui veut dire que l’on en revient à 1789, comme par enchantement ! Mais le Premier Consul n’appliquera pas vraiment ces principes et finira par établir l’Empire. Le Code Civil du 31 mars 1804 ne reprendra pas les idées avant-gardistes de la Constitution de l’An I. En ce sens, Napoléon Ier apparaît bien comme un homme essentiellement de droite voire d’extrême droite avec l’établissement d’une noblesse d’empire et du rétablissement de l’esclavage dans les colonies, à l’exception de la période des Cent Jours en 1815 durant laquelle il avait fait d’importantes concessions sociales.
Ce même Bonaparte prend le pouvoir entre le 18 et le 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799). Son discours au soir de son coup d’Etat est bien connu : « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont commencée ! Elle est finie ! » Ce qui veut dire que l’on en revient à 1789, comme par enchantement ! Mais le Premier Consul n’appliquera pas vraiment ces principes et finira par établir l’Empire. Le Code Civil du 31 mars 1804 ne reprendra pas les idées avant-gardistes de la Constitution de l’An I. En ce sens, Napoléon Ier apparaît bien comme un homme essentiellement de droite voire d’extrême droite avec l’établissement d’une noblesse d’empire et du rétablissement de l’esclavage dans les colonies, à l’exception de la période des Cent Jours en 1815 durant laquelle il avait fait d’importantes concessions sociales./http%3A%2F%2Fjournal-audible.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2Fgraphe-droite-gauche-5ieme-rep.jpg)

/image%2F0958434%2F20220805%2Fob_26deff_image.jpg)


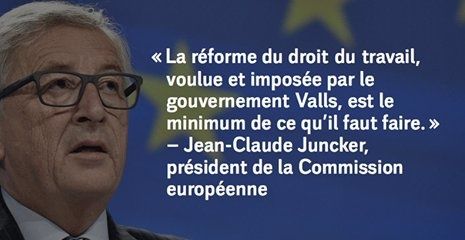

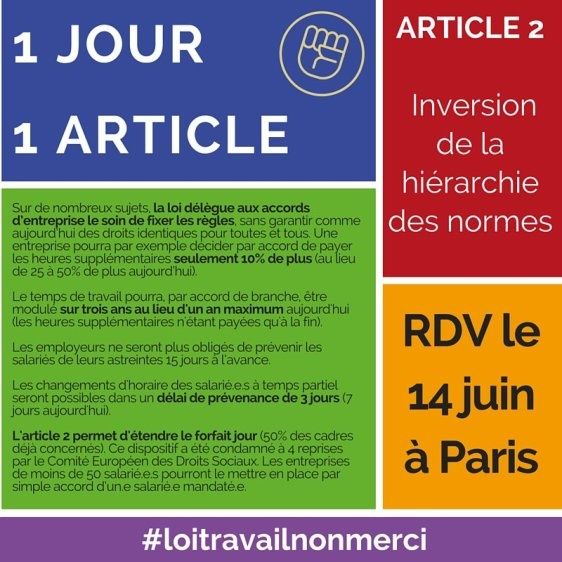
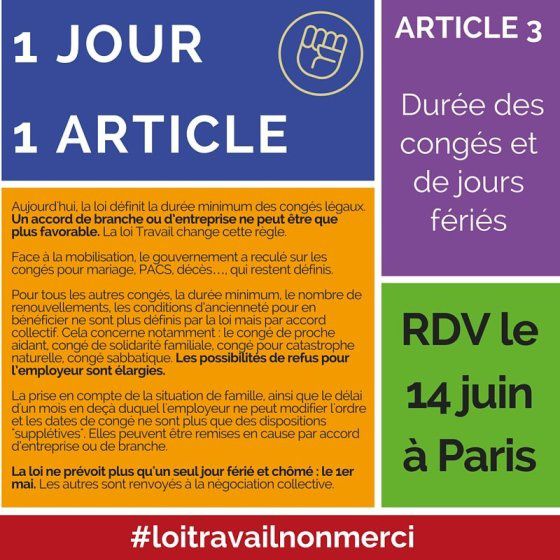


/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_e71986_dscn3779.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_e7184a_dscn3780.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_6ac414_dscn3781.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_8fbac3_dscn3782.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_07db76_dscn3783.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_ac294c_dscn3784.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_c87d80_dscn3788.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_d1a748_dscn3789.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_12f428_dscn3790.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_2dc8f0_dscn3791.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_aab135_dscn3799.JPG)
/image%2F0958434%2F20160615%2Fob_d101d1_pg.JPG)

/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)
/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)
/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)
/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)
/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)
/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)