Les socialistes français ont joué un rôle pionnier et directeur dans la « libéralisation » de l’économie à l’échelle mondiale. C’est la thèse que défend Rawi Abdelal dans Capital Rules.[1]
Sources : Reporterre le quotidien de l'écologie le 12/04/2012 par Raphaël Kempf[21]
Le candidat[2] est lyrique et la pique fait mouche. Son « adversaire », son « véritable adversaire […] n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance ». En ce 22 janvier, au Bourget, François Hollande a prononcé le discours qui lui permettra peut-être d’emporter la bataille présidentielle. En s’attaquant à la finance, il se place aux côtés des nombreux Français qui espèrent que soit mis fin aux excès du capitalisme financier mondialisé.
Il n’est pourtant pas sûr que cet adversaire soit vraiment anonyme. Il n’est pas évident qu’aucun parti ne soit à ses côtés pour lui permettre de croître. L’étude de l’histoire récente de la mondialisation montre au contraire que la finance a bénéficié de soutiens de poids. Sans des gouvernements, sans des autorités publiques détentrices du droit de promulguer des lois, la finance n’aurait pas pu se libéraliser. Et, pourrait-on ajouter, sans le choix fait par les socialistes français d’embrasser le capital, la finance n’aurait pas pu, pour reprendre les mots de François Hollande, prendre « le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies ».
 Politiques de la mondialisation financière
Politiques de la mondialisation financière
Ainsi, lorsque le candidat affirme dans son discours que « la finance s’est affranchie de toute règle, de toute morale, de tout contrôle », cela pose avant tout une interrogation d’ordre grammatical. La « finance » est ici le sujet, comme si elle avait pu faire exploser d’elle-même les chaînes qui entravaient son déploiement. D’après François Hollande, la finance s’est libérée toute seule, par la seule grâce de son dynamisme et de sa force dévastatrice, peut-on penser. Ce récit est faux. Il a fallu que des gouvernements élus, dans plusieurs pays mais principalement en France, décident de libéraliser les mouvements de capitaux pour que la finance puisse effectivement se déployer.
Comme en matière commerciale, où la libéralisation des échanges résulte de choix politiques traduits à l’échelle mondiale dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce, ce sont, en matière financière, des décisions politiques qui ont permis de libérer les mouvements de capitaux. Ces événements majeurs de notre époque ne sont pas le fruit d’un mouvement naturel s’imposant avec la puissance de l’évidence. Ils résultent, nous n’y insisterons jamais assez, de choix politiques conscients.
Tout l’intérêt du livre important de Rawi Abdelal est de rappeler cette composante politique de la mondialisation financière. L’auteur, professeur à la Harvard Business School et spécialiste d’économie politique internationale, explique, dans sa préface à Capital Rules, avoir eu envie de comprendre pourquoi l’idée selon laquelle les capitaux doivent circuler librement au-delà des frontières constitue de nos jours « l’orthodoxie » de la pensée économique. C’est donc à une reconstruction historique de l’émergence de cette idée que se livre Rawi Abdelal, qui explique vouloir « écrire une histoire intellectuelle, juridique et politique de la mondialisation financière » (p. x). C’est lors de ses recherches qu’il a découvert le rôle de premier plan qu’a joué la France dans cette entreprise.
Persuadé à l’origine, comme tout le monde, que la libéralisation de la finance est le fruit de l’activisme de Wall Street, du Trésor américain et de politiciens de droite, il « a au contraire découvert le leadership de l’Europe dans la rédaction des règles libérales de la finance globale » (p. xi). C’est d’abord de cette découverte, dont l’auteur semble être le premier étonné, que le livre fait part. « L’émergence d’un régime libéral de la finance globale ne peut que difficilement se comprendre comme un complot, et encore moins comme un complot orchestré par des politiciens et des banquiers américains. Les conspirateurs les plus influents ont été des socialistes français, des banquiers centraux allemands et des bureaucrates européens. » (p. 21) – ces derniers pouvant également être membres du Parti socialiste français : c’est notamment le cas de Jacques Delors et Pascal Lamy.
L’auteur propose ainsi, de son propre aveu, « une histoire révisionniste de l’émergence de la finance globale » (p. 218) et montre au final que celle-ci n’était « ni inexorable, ni inévitable » (p. 223). S’appuyant sur l’étude des archives de plusieurs organisations internationales (UE, FMI, OCDE) et sur de nombreux entretiens conduits avec les « conspirateurs » de l’époque – hauts fonctionnaires français ou européens, ministres des deux côtés de l’Atlantique, analystes des agences de notation –, le livre offre une histoire vivante de la globalisation financière, racontée par ses acteurs de manière souvent assez libre.
Le lecteur écoutera ainsi avec amusement Pascal Lamy raconter à Rawi Abdelal que « lorsqu’il s’agit de libéraliser, il n’y a plus de droite en France. La gauche devait le faire, parce que ce n’est pas la droite qui l’aurait fait » (p. 62-631). L’actuel directeur général de l’OMC confiera encore à l’auteur que « des politiciens français ont joué un rôle majeur dans la promotion de la libéralisation du capital en Europe, à l’OCDE et au FMI » (p. 13).
Comment ne pas constater la contradiction qui existe entre ces déclarations, qui reconnaissent clairement que la mondialisation résulte de choix politiques, avec ce que ce même Pascal Lamy expliquait récemment au journal Le Monde ? « Les moteurs de la mondialisation sont technologiques : le porte-conteneurs et Internet. Gageons que la technologie ne reviendra pas en arrière[4] ! » Alors, la mondialisation, choix politique ou conséquence naturelle du progrès de l’histoire et de la technique ?
Rawi Abdelal, on l’aura compris, décortique les choix politiques, notamment étatiques, relatifs à la circulation des capitaux. Comme l’explique un professeur de droit, la « surveillance [de l’État] s’est principalement manifestée sous la forme d’un contrôle plus ou moins strict sur les mouvements de capitaux, allant de la simple observation à des fins statistiques jusqu’à une interdiction de principe tempérée par un système d’autorisations chichement accordées. L’objectif fondamental des États a longtemps été de veiller à la santé de leur monnaie, de lutter contre l’évasion de leurs réserves en devises et, plus généralement, de contrôler leur balance des paiements »[5].
Ce contrôle n’est plus très bien vu aujourd’hui car le « libéralisme ambiant rend suspectes, voire insupportables, les mesures restrictives auxquelles s’attachent encore plusieurs États »[6]. Alors que le contrôle étatique des capitaux était la norme de la plupart des pays de la planète au début des années 1980, elle n’est plus aujourd’hui que celle de certains pays du Sud ; la liberté des capitaux concerne désormais l’ensemble du monde dit développé. Le livre de Rawi Abdelal raconte ce qui s’est passé entre ces deux époques et comment nous en sommes aujourd’hui arrivés à une situation dans laquelle, comme le dit encore François Hollande, « il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses » d’un pays à un autre et sans contrôle des autorités publiques.
Capital Rules – dont le titre peut signifier aussi bien « les règles du capital » que « le capital gouverne » – permet ainsi de comprendre comment s’est construite la finance globale en rappelant le caractère historique de telle ou telle orthodoxie économique, en opposant deux types de mondialisation (celle de style « européen » fondée sur des institutions et des règles et celle de style « américain » qui se veut plus spontanée ou ad hoc, pour reprendre les termes de l’auteur), et en insistant sur l’importance de certains hommes politiques, dont des socialistes français. On pourra regretter – même si là n’est pas le véritable objet du livre – que Rawi Abdelal ne prenne pas la mesure de l’ampleur de sa découverte sur l’avenir des gauches de gouvernement en général et du socialisme français en particulier.
 Relativité de l’orthodoxie économique
Relativité de l’orthodoxie économique
Rawi Abdelal montre en revanche très bien comment chaque époque a tenté de justifier ses choix politiques concernant les mouvements de capitaux en les présentant comme naturels. « Les métaphores religieuses qui se répandent dans l’étude et les orientations pratiques du système monétaire international – le dogme, l’hérésie, l’orthodoxie – laissent penser, comme c’est souvent le cas avec un vocabulaire aussi radical, qu’elles ne sont pas fondées sur des bases solides » (p. 218).
Et en effet, la relativité de ce vocabulaire reli gieux se révèle sur le plan historique : « Le contenu de l’orthodoxie financière a été profondément transformé au cours du siècle précédent, et plus d’une fois. […] Pourquoi le contrôle des capitaux était-il hérétique au début du xxe siècle, orthodoxe au milieu, et de nouveau hérétique à la fin ? » (p. ix). En effet, de manière générale, avant la première guerre mondiale, les taux de change étaient fixes et les capitaux et le commerce libres, tout comme « les gens traversaient les frontières nationales avec peu de contraintes » (p. 4) ; Keynes, cité par l’auteur, se félicitait de pouvoir se déplacer librement et échanger or ou monnaie sans contrainte. La guerre a naturellement conduit les gouvernements à suspendre la convertibilité de leur monnaie avec l’or et d’autres monnaies, et la crise des années 1930 a poussé les États à accroître les contrôles sur les mouvements de capitaux.
La fin de la seconde guerre mondiale donne naissance au système de Bretton-Woods, période qualifiée par l’auteur de « libéralisme encastré » (« embedded liberalism ») pendant laquelle le capital était « gouverné » (« capital ruled »). Le consensus de l’époque était « extraordinaire » (p. 43) en ce que le monde estimait naturel de contrôler les mouvements de capitaux alors même que l’orthodoxie était inverse quelques décennies plus tôt. « Le capital devait être contrôlé et ce, pour une raison importante : les gouvernements étaient supposés être autonomes des forces du marché » (p. 44). Les règles de l’époque ont codifié le droit des États de contrôler les mouvements de capitaux, notamment à court terme, dans les textes fondateurs du FMI, de la Communauté européenne et de l’OCDE. Ce sont certains de ces textes qui seront transformés dans les années 1980, sous l’impulsion de socialistes français, pour obliger les États à ouvrir les vannes aux mouvements de capitaux.
La période suivante est celle d’une mondialisation « ad hoc » de la finance. Ainsi, « au cours des années 1960, les gestionnaires, investisseurs et spéculateurs se sont frayé un chemin de manière ingénieuse parmi la pléthore de règlements qui encadraient leurs pratiques » (p. 7). Cette période est celle d’une mondialisation spontanée où « cette créativité » (ibid.) des marchés eux-mêmes permet d’étendre le domaine de la finance, malgré les contraintes étatiques sur les mouvements de capitaux.
La place consacrée à cette période dans Capital Rules est minime. Cela peut étonner car il est souvent admis que les marchés se sont libéralisés d’eux-mêmes, et la logique de cette époque semble correspondre au récit dominant. Cette période de mondialisation « ad hoc » pourrait ainsi être une preuve du caractère spontané, voire naturel, de l’extension du domaine de la finance. On pourrait presque penser que, si Abdelal avait pleinement étudié cette période et en avait déroulé la logique, ses conclusions auraient été contraires à la découverte dont il nous fait part dès les premiers paragraphes de son livre. Autrement dit, François Hollande pourrait facilement s’appuyer sur l’histoire de cette période pour étayer sa thèse d’une finance sans visage.
C’est d’ailleurs là une des principales critiques qui a été adressée à Capital Rules par des commentateurs, notamment en France. Jérôme Sgard rappelle ainsi que « la globalisation financière est d’abord une affaire d’investisseurs privés et d’arbitrage de marchés »[7] et lui reproche de gonfler l’importance des règles, du politique et des organisations internationales dans la libéralisation financière. Son livre insisterait trop sur les décisions prises en conscience par des acteurs politiques réalisant un dessein, et pas assez sur leur caractère souvent court-termiste et contingent. Il en oublierait en outre jusqu’au rôle essentiel des marchés.
Peut-être peut-on reprocher à Abdelal d’avoir voulu, dès le départ, partir en quête de normes figées pour raconter la mondialisation financière. Tout comme il est vrai qu’on ne saurait écrire l’histoire d’un peuple en étudiant uniquement ses codes et ses lois, il paraît impossible d’expliquer la mondialisation en ne s’intéressant qu’au droit international. Son approche serait donc trop institutionnelle et juridique. La loupe utilisée, à force de grossir le trait, donnerait-elle une image faussée du phénomène étudié ?
Si, effectivement, Capital Rules passe peut être trop rapidement sur cette période où les forces du marché auraient elles-mêmes mondialisé la finance, il montre toutefois que, même ici, les marchés n’auraient rien pu faire sans les États. Plusieurs éléments avancés par Abdelal permettent ainsi de relativiser la thèse de la « créativité » spontanée des marchés. Ainsi, il rappelle que, dans les années 1960, les premiers signes de la mondialisation financière « ont émergé du fait des acteurs du marché, avec l’accord tacite des États-Unis et du Royaume-Uni » (p. 8). Ces deux pays ont encouragé ce mouvement en relâchant les contrôles sur les mouvements de capitaux.
Le second élément avancé par l’auteur a trait aux agences de notation. Elles ont joué un rôle essentiel dans cette mondialisation « spontanée ». Rawi Abdelal leur consacre un chapitre important et esquisse une fine analyse de leur rôle dans le système financier et dans la définition de l’orthodoxie économique. Si le contenu de l’orthodoxie défendue par les agences (Standard & Poor’s et Moody’s, deux agences qui forment, selon l’auteur, un « duopole » ou un « double monopole ») a pu évoluer avec le temps, le fameux « triple A » a toujours été accordé uniquement aux États ouverts au commerce et intégrés au système financier global (p. 178). Et si les critères de notation développés par les agences ont pu prendre autant d’importance, c’est parce que des règles nationales, américaines en premier lieu, y font référence. « La puissance de S&P et Moody’s provient en partie des informations exprimées par leurs notes, mais aussi de la très grande intégration des notations de crédit dans les réglementations financières nationales » (p. 8). « Ni publiques, ni privées » (p. 173), ou alors publiques et privées à la fois, les agences de notation exercent un pouvoir qui leur a été délégué par les gouvernements et les marchés. Leurs notations acquièrent ainsi « force de loi » par la grâce de cette délégation. Autrement dit, même là où la libéralisation financière paraît être spontanée ou « ad hoc », elle résulte d’une délégation d’autorité par des pouvoirs publics.
Ce bref tableau historique aura permis à Rawi Abdelal de déconstruire certaines évidences en rappelant le caractère contingent des idées qui peuvent apparaître successivement orthodoxes ou hétérodoxes en fonction des époques. Et, à cette mondialisation financière spontanée et approuvée par les États-Unis et le Royaume-Uni, il oppose le projet européen, français et socialiste de maîtriser la mondialisation en l’encadrant par des règles, fussent-elles libérales.
 Où l’on apprend que les socialistes renoncèrent à discipliner le capital
Où l’on apprend que les socialistes renoncèrent à discipliner le capital
L’Europe a joué un rôle essentiel dans la codification des règles de libéralisation financière, et son évolution au cours des années 1980 permet de le mesurer. Le traité de Rome de 1957 ne faisait de la liberté des mouvements de capitaux qu’une liberté secondaire par rapport aux autres libertés économiques fondamentales[8]. « Le capital devait être, selon le langage de l’époque, « discipliné » – obligatoirement investi dans le pays pour créer des emplois et des revenus fiscaux, qui permettraient alors de financer l’État-providence » (p. 48).
Dans un arrêt de 1981, la Cour de justice des Communautés européennes pouvait ainsi affirmer que « les mouvements de capitaux présentent des liens étroits avec la politique économique et monétaire des États membres. Au stade actuel, on ne saurait exclure que la liberté complète de tout mouvement de capital puisse compromettre la politique économique de l’un ou de l’autre des États ou provoquer un déséquilibre de sa balance des paiements » [9].
Cette « situation a changé radicalement en juin 1988 » (p. 57), lorsqu’une directive essentielle est adoptée et libéralise les mouvements de capitaux entre États membres[10]. En 1992, le traité de Maastricht obligera les États membres à libéraliser ces mouvements également dans leurs relations avec les États tiers. Ainsi, en moins de dix ans, le capital a gagné le droit de circuler librement alors même que cela pouvait « compromettre la politique économique de l’un ou de l’autre des États ». Cette transformation radicale constitue le nœud de Capital Rules. L’auteur s’interroge : « Une question essentielle est alors de savoir ce qui a changé en Europe entre le début des années 1980 – lorsqu’une initiative pour réécrire les règles de la finance européenne a échoué alors même que le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas la soutenaient avec enthousiasme – et la fin des années 1980, lorsque les fondements institutionnels de la finance européenne ont été complètement restructurés. […] La réponse est presque trop simple : la France a changé. La simplicité de cette réponse symbolise l’un des virages les plus importants de l’histoire économique moderne » (p. 57).
C’est en recherchant ce qui s’est passé en France à cette période que Rawi Abdelal découvre le rôle essentiel de certains socialistes autoproclamés modernisateurs. « L’histoire de l’intégration financière européenne est aussi nécessairement l’histoire de la manière dont la gauche française s’est convertie au capital » (p. 58).
Capital Rules entreprend alors de raconter l’histoire – bien connue de ce côté-ci de l’Atlantique – des premières années Mitterrand et du tournant de la rigueur de mars 1983, que l’auteur décrit comme un « revirement » (« the Mitterrand U-turn »). Il rappelle ainsi les contraintes économiques extérieures et la fuite des capitaux à la suite de l’élection de François Mitterrand, ainsi que les mesures drastiques de contrôle des changes qui ont suivi, puis l’assouplissement général de ces mêmes contrôles à partir de la fin 1983 à la suite de ce fameux tournant. Ce moment essentiel a pu être décrit dans une note de la très officielle Fondation Jean-Jaurès comme « le moment du retournement, celui où se concrétise le basculement de l’idéologie à la réalité économique »[11]. La référence à la « réalité » laisse songeur. Il pourrait s’agir ici de l’autre nom de la « pensée unique », expression utilisée avec bonheur, et en français dans le texte, par Rawi Abdelal pour décrire cette année 1983 où les règles de l’orthodoxie économique ont été adoptées par l’ensemble du spectre politique français.
La conversion des socialistes au capital peut être décrite comme un mouvement en trois temps. Le premier est celui où le gouvernement socialiste se retrouve confronté aux marchés internationaux. À l’arrivée de Mitterrand au pouvoir, « un choix semblait toujours être possible » (p. 58), le politique paraissait avoir une marge de manœuvre sur l’économie de manière à favoriser la redistribution des richesses. Mais ce projet échoua rapidement, raconte Abdelal, « en partie parce que les marchés financiers ne faisaient pas confiance au nouveau gouvernement français » (p. 58). Le livre ne s’attarde pas ici sur l’importance du rapport entre marchés et gouvernement, même s’il développera dans un autre chapitre une analyse de ce rôle nouveau des marchés, qui accordent ou non leur confiance aux politiques publiques. Les premières années Mitterrand pourraient pourtant être considérées comme un exemple typique de ce poids nouveau des marchés dans les choix politiques.
À cette nouvelle contrainte, le gouvernement a répondu en renforçant les contrôles sur les mouvements de capitaux, lesquels sont apparus à certains ministres et hauts fonctionnaires comme des règles inefficaces et nuisibles, surtout aux classes moyennes. Le deuxième temps est donc celui du débat sur la nature de la politique à adopter dans ces circonstances. Ce débat s’est déroulé entre les membres du gouvernement et quelques experts, à l’exclusion du Parti socialiste, de ses militants, et bien évidemment du peuple. On rappellera rapidement que le ministre des Finances Jacques Delors et le Premier Ministre Pierre Mauroy défendaient la rigueur et le maintien de la France dans le système monétaire européen, tandis que d’autres préconisaient « l’autre politique » (p. 59, en français dans le texte) visant à défendre l’autonomie de la France par rapport aux marchés et à l’Europe. Le tournant interviendra lorsque le ministre du Budget Laurent Fabius et le secrétaire général de l’Élysée Pierre Bérégovoy accepteront la rigueur et convaincront le président.
Le troisième temps est donc celui de la rigueur et du relâchement des contrôles des mouvements de capitaux. Au-delà des débats de personnes au sein du gouvernement, les motivations des socialistes acteurs de ce tournant permettent de mettre en lumière une inflexion radicale du sens de la politique à gauche.
En effet, si l’on en croit l’auteur, l’une des raisons déterminantes ayant poussé le gouvernement à prendre ce tournant est le constat selon lequel les contrôles des capitaux nuisaient surtout aux classes moyennes, tandis que les riches arrivaient sans difficulté à les contourner. Le « carnet de change » était alors impopulaire et limitait les devises auxquelles avaient droit les Français lors de leurs déplacements à l’étranger. Il serait intéressant de savoir quelle proportion des « classes moyennes » pouvait, en 1983, prendre ses vacances à l’étranger et était réellement sous la contrainte du carnet de change. Quoi qu’il en soit, en se basant sur des entretiens avec des acteurs de cette période, Abdelal considère qu’il y a là un fondement du tournant pris par les socialistes. En outre, une autre motivation du tournant est l’objectif d’utiliser des « politiques libérales ostensibles comme des outils à objectif social » (p. 29).
L’auteur y insiste à de nombreuses reprises : l’idée, avec la libéralisation du secteur bancaire français était, comme pour l’assouplissement du contrôle des changes, « d’apporter les bénéfices du capital aux classes moyennes » (p. 62). Enfin, la volonté de « moderniser » la France est apparue à certains responsables socialistes comme un moyen de gagner une crédibilité politique personnelle en mettant en avant leur compétence et leur réalisme. Que le terme de modernisation soit associé à la libéralisation financière signe un changement d’époque, une transformation du vocabulaire, un tournant.
Le récit officiel de l’abdication de la gauche devant les forces du marché doit donc être réécrit. « L’année 1983 n’a pas été l’année de la capitulation de la gauche française devant la finance, mais celle de son ralliement à celle-ci », écrit Aquilino Morelle dans une tribune de presse[12]. Bien plus, les idées et pratiques nées en France à cette période – à savoir que la mondialisation peut et doit être maîtrisée par des règles, fussent-elles libérales – constituent un véritable schème explicatif cohérent. « La seule convergence décisive des visions libérales était à Paris. C’est le ’ consensus de Paris’, et non celui de Washington, qui est avant tout responsable de l’organisation financière mondiale telle que nous la connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire centrée sur les économies développées de l’UE et de l’OCDE, et dont les codes libéraux constituent le socle institutionnel de la mobilité des capitaux »[13].
À partir de ce tournant et de la cristallisation de ce qu’on n’appelait pas encore le « consensus de Paris », les architectes français de la rigueur s’emploieront à écrire des règles libérales dans les textes fondateurs de certaines organisations internationales, Europe en tête. C’est Jacques Delors, devenu président de la Commission européenne en 1985, et son directeur de cabinet Pascal Lamy, qui prépareront la directive de 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux. Le traité de Maastricht permettra, trois ans plus tard, d’inscrire ces règles dans les textes fondamentaux de l’Union européenne. À partir de ce moment, il n’est plus possible aux États membres de limiter les mouvements de capitaux entre eux ou avec des États tiers.
Rapidement, le « consensus de Paris » s’étend au-delà des frontières de l’Europe. De hauts fonctionnaires français du Trésor, artisans de la rigueur lorsque la gauche était au pouvoir, se retrouvent à des postes clés au sein de l’OCDE (Henri Chavranski) ou au FMI (Michel Camdessus) et tentent de faire interdire par leurs organisations respectives les contrôles sur les mouvements de capitaux de leurs membres. La tentative réussit à l’OCDE, qui réunit des pays dits développés, mais pas au FMI, où elle ne résiste pas aux crises financières de la fin du xxe siècle dans plusieurs pays émergents. Dans les années 1990, en effet, sous la direction de Michel Camdessus, le FMI avait tenté d’étendre son mandat à la sphère du contrôle des mouvements de capitaux. Mais le Fonds ne réussira pas à codifier une telle règle. Entre-temps, en septembre 1998, la Malaisie, par exemple, est parvenue à surmonter la crise en réinstaurant un contrôle des capitaux. Il devenait dès lors impossible de cristalliser une telle règle au niveau du FMI. Il n’en reste pas moins que la liberté de la finance est aujourd’hui la règle dans l’Union européenne et dans l’OCDE.
 De quoi le « consensus de Paris » est-il le nom ?
De quoi le « consensus de Paris » est-il le nom ?
Des socialistes français, c’est entendu, ont formulé le consensus de Paris sur la mondialisation financière. Mais même si Rawi Abdelal qualifie ce fait de « paradoxe français », il paraît ne pas en prendre toute la mesure politique. Il semble au contraire s’amuser de sa découverte, comme si elle n’avait d’autre intérêt que cosmétique, et la prend parfois à la légère – elle ne serait qu’un moyen de pimenter son récit. Des Français, des socialistes, à l’origine du capitalisme financier contemporain, dites-vous ? Voilà qui a de quoi faire sourire les rédactions outre-Atlantique. Et le Wall Street Journal ne s’y est pas trompé qui salue ce livre tout en s’amusant du rôle de cette « bande de socialistes français » dans l’histoire[14].
En France, on l’a vu, Capital Rules n’a fait naître aucun débat politique, bien qu’il ait fait l’objet de quelques recensions assez techniques[15]. Les critiques se sont focalisées sur le rôle minime accordé aux marchés par l’auteur, et son insistance sur des hommes et des institutions. Pour Jérôme Sgard, « Abdelal en fait un peu trop avec nos Quatre Socialistes » (Delors, Lamy, Camdessus, Chavranski), qui ont propagé la bonne parole libérale dans les institutions internationales. Il est vrai qu’il insiste beaucoup sur le poids des hommes, lesquels ne sont pourtant que de hauts fonctionnaires au milieu d’organisations aux intérêts multiples. Néanmoins, au-delà de ces quatre personnes, le tournant de 1983 a été décidé, on l’a vu, par un gouvernement socialiste ; et ce tournant a permis à l’Europe de prendre elle aussi le virage de la libéralisation financière. La question n’est donc pas de savoir quel est le rôle individuel de tel ou tel, mais plutôt de voir une gauche de gouvernement prendre dans son ensemble une direction tout autre que celle pour laquelle elle a été élue.
C’est en cela, sur le plan politique, que ce livre pose, en France, des questions difficiles. Car il ne s’agit pas de faire une critique interne de Capital Rules, du point de vue de l’expert en économie ou du spécialiste des institutions internationales. Il faut au contraire voir ce qu’il peut nous dire et nous apprendre de politique. Que penser de ce ralliement des socialistes ? Signe-t-il la fin de la possibilité même de construire un projet émancipateur à gauche ?
Dans son remarquable ouvrage sur la décennie 1980, François Cusset a souligné cette grande victoire paradoxale de la gauche. « Les milieux économiques eux-mêmes se félicitent d’une crise qui pousse le nouveau pouvoir à des réformes allant dans le sens de leurs intérêts : rigueur salariale, allégement de la fiscalité, modernisation des marchés financiers, flexibilité accrue de l’emploi. La gauche est plus libérale, plus efficacement libérale que la droite, se réjouissent-ils, et elle seule pouvait venir à bout en trois petites années d’un anticapitalisme français qu’on croyait indéracinable. » Que faire, désormais, de cette gauche de gouvernement ? Peut-on croire que la rigueur n’était qu’une « parenthèse »[16], comme l’a expliqué à l’époque, en 1983, le premier secrétaire du PS[17] ?
Lionel Jospin dirigeait alors un parti « pensé avant tout comme une organisation de mobilisation de l’électorat, au détriment des autres fonctions dévolues à un parti politique, comme notamment la fonction doctrinale »[18]. Il a en effet été démontré que le parti avait été marginalisé dans les choix faits par le gouvernement de François Mitterrand[19]. L’appareil militant n’avait pas son mot à dire, pas plus que le peuple, à qui était imposé le virage.
C’est ici que le livre de Rawi Abdelal soulève une autre interrogation. Si ce sont bien des « choix politiques » qui ont permis l’expansion de la finance, la nature de cette « politique » est pour le moins réductrice. Le terme ne vise ici que des choix faits au niveau d’experts gouvernementaux, hauts fonctionnaires ou ministres, qui ont débattu entre eux des options à prendre. Le peuple est réduit aux seules « classe moyennes » au profit desquelles auraient été opérés le tournant de la rigueur et la libéralisation financière et bancaire. Ainsi, au-delà du seul ralliement au capital, l’année 1983 signerait-elle aussi l’abandon par la gauche des classes populaires ?
Comment lire, également, la fine analyse par l’auteur de la notion de crédibilité ? Nous vivons, explique-t-il, à « l’ère de la crédibilité ». C’est-à-dire que « le succès d’une politique dépend fondamentalement et nécessairement de la manière dont les marchés financiers réagissent. […] Lorsque les marchés ne croient pas qu’une politique va améliorer les performances économiques d’un pays, alors cette politique ne peut pas réussir » (p. 163). Doit-on en déduire que les jeux sont faits, que la politique n’existe plus ? « En France, écrit encore François Cusset, comme dans le reste du monde occidental, les années 1980 sont l’aboutissement d’un processus biséculaire d’autolimitation économique de la politique, sinon même le résultat d’une très vieille tentative, bien sûr impossible, pour abolir la politique »[20]. Il est vrai qu’une fois que les règles du capitalisme mondialisé sont inscrites dans des traités internationaux, lesquels nécessitent l’accord de plusieurs dizaines de pays pour être modifiés, il paraît impossible de revenir dessus et de choisir une autre politique. En codifiant ces règles au cours des années 1980, le politique s’est lui-même interdit, pour l’avenir, de faire d’autres choix.
Le livre de Rawi Abdelal, s’il ne se prononce pas sur l’avenir du politique, a le mérite de mettre au jour cette histoire. Et il paraît étonnant qu’il ait été ignoré en France, alors même que ce pays est le premier concerné. Pourrait-on en conseiller la lecture au candidat socialiste ? Cela lui permettrait peut-être de formuler avec plus de mesure et, serait-on tenté de dire, avec plus de réalisme, ses diatribes contre la finance. Connaître et assumer le passé de son propre parti lui permettrait peut-être de le dépasser, et de ne pas tromper l’attente de ces électeurs éblouis par les charmes d’un candidat normal, proche des gens, et dont les attaques contre la finance paraissent si convaincantes.
Note :
[1] À propos du livre de : Rawi Abdelal, Capital Rules : The Construction of Global Finance, Cambridge, Harvard University Press, 2007, 304 p., 15,15 £.
[2] F. Hollande
[3] Rawi Abdelal, « Le consensus de Paris : la France et les règles de la finance mondiale », trad. R. Bouyssou, Critique internationale, 2005/3, n° 28, p. 96. (Cet article recoupe en partie certains chapitres de l’ouvrage commenté. Nous avons choisi d’utiliser la traduction de Rachel Bouyssou lorsque cela était possible.)
[4] Pascal Lamy, « La démondialisation est un concept réactionnaire », entretien paru dans Le Monde, 1er juillet 2011
|5] Claude J. Berr, « Circulation des capitaux – Paiements internationaux et investissements », Répertoire commercial Dalloz, octobre 2009, p. 2.
[6] Ibid.
[7] Jérôme Sgard, « Lectures », Critique internationale, n° 42, janvier-mars 2009, p. 171-172.
[8] Les textes fondateurs du droit de l’Union européenne (souvent dénommé « droit communautaire »), et en premier lieu le traité de Rome, établissent quatre libertés économiques fondamentales pour permettre la réalisation du marché intérieur : la libre circulation des produits, des personnes et des capitaux, ainsi que la libre prestation de services. Elles ne doivent évidemment pas être confondues avec les « libertés fondamentales » du sens commun et des juristes de droit public (libertés d’expression, de manifestation, etc.).
|9] CJCE, Casati, 11 novembre 1981, C-203/80, §9, p. 2614, cité par Rawi Abdelal p. 55.
[10] Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité.
[11] Floriane Galeazzi et Vincent Duchaussoy, « 1983 : le “tournant” en question », Note n° 90, Fondation Jean-Jaurès, 2 mai 2011, p. 10.
[12] Aquilino Morelle, « La démondialisation inquiète les partisans d’un libéralisme aux abois », Le Monde, 8 septembre 2011.
[13] Rawi Abdelal, « Le consensus de… », art. cit, p. 90.
[14] Matthew Rees, « Why Money Can Now Make Its Way Around the World », The Wall Street Journal, 14 février 2007.
[15] Jérôme Sgard, art. cit. Voir aussi Nicolas Véron, « Le “French paradox” de la libéralisation financière », La Vie des Idées, septembre 2007.
[16] Cité par Thierry Barboni, « Ressorts du discours socialiste lors du « virage de la rigueur » », Nouvelles Fondations, 2006, n° 2.
|17] François Cusset, La Décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2006, p. 93.
[18] Ibid., p. 62.
[19] Ibid.
[20] Ibid, p. 214.
[21] Raphaël Kempf est juriste, titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Il est l’auteur de L’OMC face au changement climatique. Étude de droit international (Pedone, 2009)
Pour en savoir plus :
- Le sacro-saint ratio de 3% du PIB.... une invention franco-socialiste

/image%2F0958434%2F20231214%2Fob_0741d4_banniere-graphique-ouvre-ta-gueule.jpg)






/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_c8327d_c5cf0j6weaihdxd.jpg)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_9a08b3_ob-50c318-c5chrdgwaaamkp6.jpg)

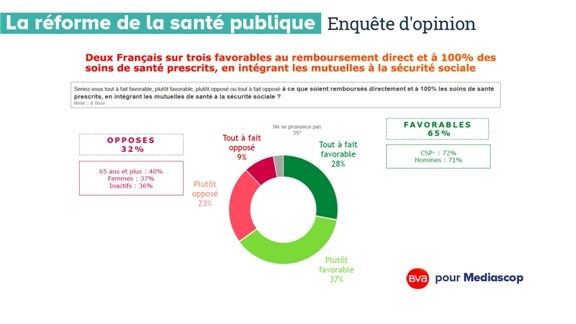
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_4c7c0b_c5cz8dexuaemj7o.jpg)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_05fc9c_c5czl3twcaa33qu.jpg)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_55464b_ob-428d7e-c5c-xy-weaqg9sk.jpg)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_3594a0_ob-8b6f65-c5c0aj-xuaaa7sn.jpg)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_97738d_c5cy9jgwqaa2r1y.jpg)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_0daf75_capture.JPG)
/image%2F0958434%2F20170219%2Fob_63df0e_ob-db9336-capture.JPG)



/image%2F0958434%2F20160925%2Fob_0cb8c6_capture3.JPG)
/image%2F0958434%2F20160925%2Fob_813918_capture2.JPG)
/image%2F0958434%2F20160925%2Fob_50dc34_capture1.JPG)
/image%2F0958434%2F20160925%2Fob_b33add_capture4.JPG)














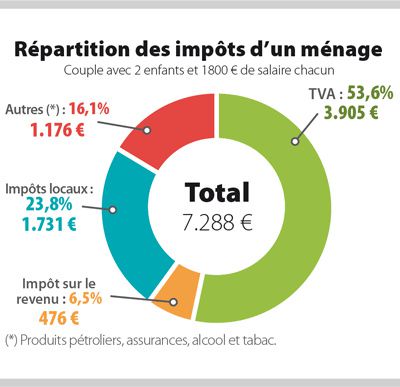


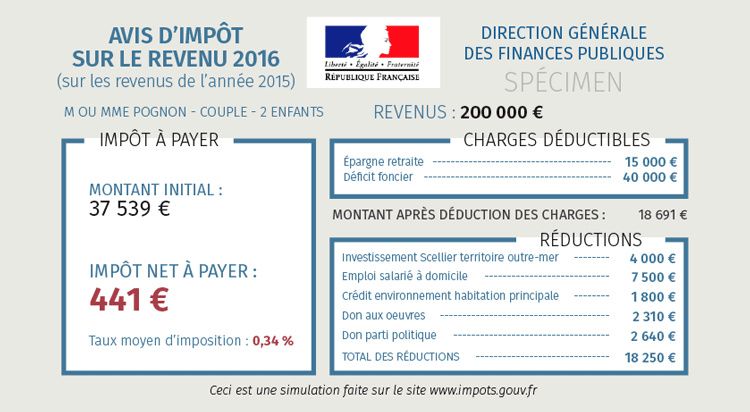
/http%3A%2F%2Fwww.cgtfinances.fr%2FIMG%2Fpng%2F06-propositions-1.png)
/http%3A%2F%2Fwww.cgtfinances.fr%2FIMG%2Fpng%2F06-propositions-2.png)








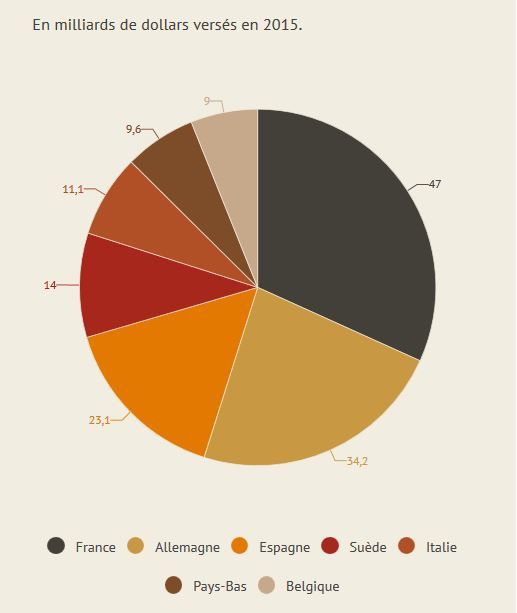






/image%2F0958434%2F20230827%2Fob_40a9dd_la-france-insoumise-c-est-quoi.PNG)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_37c0ac_fi-1.JPG)
/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_bcdc27_capture12.JPG)
/image%2F0958434%2F20221109%2Fob_4f96f8_melenchon-le-blog.PNG)
/image%2F0958434%2F20201124%2Fob_dc2de0_ob-8a-19702373-698458660342416-8748286.png)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_e894d4_image-0958434-20201124-ob-44ff1a-insou.jpg)
/image%2F0958434%2F20221110%2Fob_0bed0b_capture.PNG)
/image%2F0958434%2F20211114%2Fob_0404c9_pg.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_a9246b_capture5.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_8c9ad4_capture.JPG)
/image%2F0958434%2F20221218%2Fob_f51044_capture.PNG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_92842f_capture2.JPG)
/image%2F0958434%2F20201129%2Fob_98f9ec_capture123.JPG)